Autres articles
-
Jérôme Despey : A mon arrivée à la présidence du SIA, je voulais vraiment mettre un pays ami à l'honneur comme le Maroc
-
Pr Simon Jonas Ategbo : «Mutualiser les efforts des différentes sociétés africaines de pédiatrie»
-
Fethallah Mohammed : "Le manque de soutien et de formation ainsi que l’absence de relève ont précipité le déclin de la Renaissance Sportive de Settat"
-
Redouane Jiyed : Nous sommes appelés à apporter tout le soutien à la nouvelle génération d'arbitres et leur offrir l’opportunité de démontrer leurs compétences
-
Aurore Vinot : Je suis fascinée par la vitalité et la diversité de la scène artistique marocaine
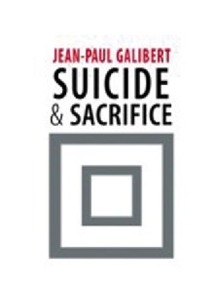
J.P. Galibert,
philosophe français, blogueur et auteur
de plusieurs essais philosophiques,
dont le dernier
s’intitule «Suicide
et sacrifice».
Il nous a accordé
cet entretien.
Libé : Pourriez-vous vous présenter au public marocain?
Jean-Paul Galibert : L’idée centrale de ma philosophie est l’inexistence, parce que je crois que la philosophie, de Parménide à Heidegger, a eu tort de considérer l’être et l’existence comme des données. Autour de nous comme en nous, on observe plutôt des choses qui ont beaucoup de mal à exister. L’existence est presque un idéal ; elle est plutôt une exigence qu’un point de départ. Mon œuvre s’adresse à tous ceux qui ont du mal à exister : d’abord les pauvres, les subalternes, les invisibles, et finalement chaque humain, au fond, puisque l’on est humain à partir d’une faille, à partir de notre manière bien à nous d’être sans être.
Vous publiez un nouvel ouvrage «Suicide et sacrifice» qui est sorti fin novembre. Sur quoi porte votre ouvrage?
C’est une introduction à la société de sacrifice où nous entrons. Car le capitalisme, dont nous sortons, restait un mode de production, tandis que l’hypercapitalisme, où nous entrons, est un mode de destruction. Son modèle de rentabilité est le travail imaginaire, par lequel nous ajoutons réellement de la valeur aux marques que nous adorons, et que nous acceptons de ce fait de payer nettement plus cher. Rien n’est plus rentable que cet hypertravail, car d’un côté nous travaillons pour une entreprise, et de l’autre nous lui versons la valeur de notre propre travail. C’est le premier travail payant. L’hypercapitalisme en conclut que le reste doit disparaître.
Dans cet ouvrage, vous écrivez «L’invitation au suicide de la publicité a l’avantage d’être socialement sélective, car, pour ceux qui ont les moyens, elle fonctionne bien comme un ordre d’achat désespéré, mais pour ceux qui sont trop pauvres, elle fonctionne comme le spectacle permanent de l’existence qui leur est refusée, et donc une incitation permanente au suicide». Vous ne trouverez pas ceci trop poussé? Comment l’expliquez-vous?
Le suicide n’est pas un but de notre société. Il a pour effet, et donc pour fonction, de plonger un grand nombre de personnes dans l’état suicidaire, où la mort est simplement envisagée, comme en toile de fond. J’analyse dans le livre les discours, les stratégies, les technologies, les pratiques sociales qui nous entretiennent dans cet état. On obtient ainsi des gens prêts à tout accepter, à tout acheter, à tout imaginer, plutôt que de mourir. Je crois qu’on imagine mal la violence du spectacle des publicités, des séries, des films dans des milieux ou à des âges où l’on ne peut en aucun cas envisager les achats correspondants. La délinquance et le suicide me semblent être des réactions à cette violence dont le propre est de nous désespérer, puisqu’elles nous montrent que nous n’avons plus aucun autre espoir que l’achat du produit. Il faut ici discerner la menace implicite, comme dans tout ordre, et c’est bien celle du suicide. Même chose lorsqu’on cherche à mesurer la rentabilité des personnes. Et pour finir, nous assurons nous-mêmes la diffusion de l’état suicidaire, en déniant l’existence aux autres, à chaque manque de respect. Mais la plupart des personnes ne se tuent pas, et ne tuent personne. La plupart des gens augmentent au contraire leur dose de spectacle. Ils y sacrifient peu à peu la totalité de leur existence. Ce qui est contagieux, c’est le rien, le manque de vécu. C’est très concret, le sentiment d’inexistence.
Dans votre œuvre «Invitations philosophiques à la pensée du rien «, vous parlez justement de votre théorie de la «pensée du rien». Pourriez-vous l’expliquer à nos lecteurs?
Le rien, c’est tout ce qui existe, et qui pourtant n’existe pas. J’ai l’impression que c’est à peu près tout. Parce qu’il y a plusieurs façons d’exister sans exister. Il y a la manière de l’être, qui consiste à rester idéal, la manière du néant, qui consiste à détruire, la manière du monde, qui est de rester imaginaire, et celle du réel, qui est certes tout à fait matériel, mais absurde, dépourvu de tout langage. Je crois qu’à peu près chaque chose, à commencer par nous-mêmes, combine ces quatre sortes de rien. A partir de là, tout est contradictoire, et l’existence devient un art difficile.
Revenons à la vie de tous les jours. Comment voyez-vous la répercussion de la crise économique sur la pensée humaine? Sur la scène culturelle européenne?
Il faudrait être certain qu’il y ait une crise. Les gens souffrent, les inégalités se creusent, c’est certain ; mais le discours sur la crise amène le plus souvent à réclamer des efforts supplémentaires aux plus démunis, et de moins en moins aux grands bénéficiaires. On s’est longtemps demandé s’il n’était pas possible de surmonter les crises du capitalisme en se passant du capitalisme. Je crois que l’hypercapitalisme est un système de la crise, qui est en train de se demander s’il ne va pas se passer de nous. Je ne sais pas si les penseurs européens ou nord-américains - ceux que je connais le mieux- mesurent suffisamment le péril que court désormais l’existence. Je crois que toute une noirceur de l’art contemporain le perçoit mieux. Dans la plupart des pays du monde, il doit être d’une évidence directe, immédiate et toujours palpable que le nouveau système social n’a pas besoin de tout le monde.
En 2011, des révoltes et soulèvements se sont déroulés presque partout dans la région arabe. Quel regard portez-vous sur ce «Printemps» arabe? Sur la montée des gouvernements islamistes?
Je connais peu, au fond, les situations de chacun des pays. J’écoute beaucoup la radio. J’y entends, comme disait Deleuze, ce que je suis censé faire semblant de croire, et je me suis d’abord méfié du soutien que les forces françaises les plus conservatrices réservaient aux mouvements révolutionnaires arabes. Le cas de la Libye est un modèle du genre. Sur le fond, je pense que l’exemple algérien nous a montré, il y a déjà longtemps, que rien d’important ne se fera dans les pays arabes sans l’islam. Dès lors, il me semble qu’il est impossible de laisser l’islam aux islamistes radicaux. Bien des conflits d’interprétation sont en cours. Les textes sacrés sont le patrimoine commun de l’humanité tout entière. A chacun de nous d’en réinventer le sens. C’est le combat d’Averroès qui continue.
Comment jugez-vous l’élan des jeunes dans le monde («Printemps arabe», mouvements des Indignés, ...) qui refusent, ou du moins le manifestent, cet «ordre» mondial de l’après crise?
Avec la plus grande sympathie, bien sûr. Mais cela ne les aide guère, et me coûte bien peu. Il faudrait que chacun fasse ce qu’il peut pour les aider et vienne avec ses outils. Moi, mes outils, ce sont mes concepts. Je crois que les idées d’hypercapitalisme, comme nouveau mode de destruction, d’hypertravail, comme nouveau travail imaginaire hautement rentable, peuvent les aider. Je crois qu’ils peuvent utiliser ma notion de sacrifice de la totalité de notre temps (de travail et de loisir). Je crois que définir notre temps comme une société sacrificielle permet de mesurer le travail du néant, et donc de susciter des réactions salutaires. Fournir des concepts, n’est-ce pas cela le travail du philosophe?
philosophe français, blogueur et auteur
de plusieurs essais philosophiques,
dont le dernier
s’intitule «Suicide
et sacrifice».
Il nous a accordé
cet entretien.
Libé : Pourriez-vous vous présenter au public marocain?
Jean-Paul Galibert : L’idée centrale de ma philosophie est l’inexistence, parce que je crois que la philosophie, de Parménide à Heidegger, a eu tort de considérer l’être et l’existence comme des données. Autour de nous comme en nous, on observe plutôt des choses qui ont beaucoup de mal à exister. L’existence est presque un idéal ; elle est plutôt une exigence qu’un point de départ. Mon œuvre s’adresse à tous ceux qui ont du mal à exister : d’abord les pauvres, les subalternes, les invisibles, et finalement chaque humain, au fond, puisque l’on est humain à partir d’une faille, à partir de notre manière bien à nous d’être sans être.
Vous publiez un nouvel ouvrage «Suicide et sacrifice» qui est sorti fin novembre. Sur quoi porte votre ouvrage?
C’est une introduction à la société de sacrifice où nous entrons. Car le capitalisme, dont nous sortons, restait un mode de production, tandis que l’hypercapitalisme, où nous entrons, est un mode de destruction. Son modèle de rentabilité est le travail imaginaire, par lequel nous ajoutons réellement de la valeur aux marques que nous adorons, et que nous acceptons de ce fait de payer nettement plus cher. Rien n’est plus rentable que cet hypertravail, car d’un côté nous travaillons pour une entreprise, et de l’autre nous lui versons la valeur de notre propre travail. C’est le premier travail payant. L’hypercapitalisme en conclut que le reste doit disparaître.
Dans cet ouvrage, vous écrivez «L’invitation au suicide de la publicité a l’avantage d’être socialement sélective, car, pour ceux qui ont les moyens, elle fonctionne bien comme un ordre d’achat désespéré, mais pour ceux qui sont trop pauvres, elle fonctionne comme le spectacle permanent de l’existence qui leur est refusée, et donc une incitation permanente au suicide». Vous ne trouverez pas ceci trop poussé? Comment l’expliquez-vous?
Le suicide n’est pas un but de notre société. Il a pour effet, et donc pour fonction, de plonger un grand nombre de personnes dans l’état suicidaire, où la mort est simplement envisagée, comme en toile de fond. J’analyse dans le livre les discours, les stratégies, les technologies, les pratiques sociales qui nous entretiennent dans cet état. On obtient ainsi des gens prêts à tout accepter, à tout acheter, à tout imaginer, plutôt que de mourir. Je crois qu’on imagine mal la violence du spectacle des publicités, des séries, des films dans des milieux ou à des âges où l’on ne peut en aucun cas envisager les achats correspondants. La délinquance et le suicide me semblent être des réactions à cette violence dont le propre est de nous désespérer, puisqu’elles nous montrent que nous n’avons plus aucun autre espoir que l’achat du produit. Il faut ici discerner la menace implicite, comme dans tout ordre, et c’est bien celle du suicide. Même chose lorsqu’on cherche à mesurer la rentabilité des personnes. Et pour finir, nous assurons nous-mêmes la diffusion de l’état suicidaire, en déniant l’existence aux autres, à chaque manque de respect. Mais la plupart des personnes ne se tuent pas, et ne tuent personne. La plupart des gens augmentent au contraire leur dose de spectacle. Ils y sacrifient peu à peu la totalité de leur existence. Ce qui est contagieux, c’est le rien, le manque de vécu. C’est très concret, le sentiment d’inexistence.
Dans votre œuvre «Invitations philosophiques à la pensée du rien «, vous parlez justement de votre théorie de la «pensée du rien». Pourriez-vous l’expliquer à nos lecteurs?
Le rien, c’est tout ce qui existe, et qui pourtant n’existe pas. J’ai l’impression que c’est à peu près tout. Parce qu’il y a plusieurs façons d’exister sans exister. Il y a la manière de l’être, qui consiste à rester idéal, la manière du néant, qui consiste à détruire, la manière du monde, qui est de rester imaginaire, et celle du réel, qui est certes tout à fait matériel, mais absurde, dépourvu de tout langage. Je crois qu’à peu près chaque chose, à commencer par nous-mêmes, combine ces quatre sortes de rien. A partir de là, tout est contradictoire, et l’existence devient un art difficile.
Revenons à la vie de tous les jours. Comment voyez-vous la répercussion de la crise économique sur la pensée humaine? Sur la scène culturelle européenne?
Il faudrait être certain qu’il y ait une crise. Les gens souffrent, les inégalités se creusent, c’est certain ; mais le discours sur la crise amène le plus souvent à réclamer des efforts supplémentaires aux plus démunis, et de moins en moins aux grands bénéficiaires. On s’est longtemps demandé s’il n’était pas possible de surmonter les crises du capitalisme en se passant du capitalisme. Je crois que l’hypercapitalisme est un système de la crise, qui est en train de se demander s’il ne va pas se passer de nous. Je ne sais pas si les penseurs européens ou nord-américains - ceux que je connais le mieux- mesurent suffisamment le péril que court désormais l’existence. Je crois que toute une noirceur de l’art contemporain le perçoit mieux. Dans la plupart des pays du monde, il doit être d’une évidence directe, immédiate et toujours palpable que le nouveau système social n’a pas besoin de tout le monde.
En 2011, des révoltes et soulèvements se sont déroulés presque partout dans la région arabe. Quel regard portez-vous sur ce «Printemps» arabe? Sur la montée des gouvernements islamistes?
Je connais peu, au fond, les situations de chacun des pays. J’écoute beaucoup la radio. J’y entends, comme disait Deleuze, ce que je suis censé faire semblant de croire, et je me suis d’abord méfié du soutien que les forces françaises les plus conservatrices réservaient aux mouvements révolutionnaires arabes. Le cas de la Libye est un modèle du genre. Sur le fond, je pense que l’exemple algérien nous a montré, il y a déjà longtemps, que rien d’important ne se fera dans les pays arabes sans l’islam. Dès lors, il me semble qu’il est impossible de laisser l’islam aux islamistes radicaux. Bien des conflits d’interprétation sont en cours. Les textes sacrés sont le patrimoine commun de l’humanité tout entière. A chacun de nous d’en réinventer le sens. C’est le combat d’Averroès qui continue.
Comment jugez-vous l’élan des jeunes dans le monde («Printemps arabe», mouvements des Indignés, ...) qui refusent, ou du moins le manifestent, cet «ordre» mondial de l’après crise?
Avec la plus grande sympathie, bien sûr. Mais cela ne les aide guère, et me coûte bien peu. Il faudrait que chacun fasse ce qu’il peut pour les aider et vienne avec ses outils. Moi, mes outils, ce sont mes concepts. Je crois que les idées d’hypercapitalisme, comme nouveau mode de destruction, d’hypertravail, comme nouveau travail imaginaire hautement rentable, peuvent les aider. Je crois qu’ils peuvent utiliser ma notion de sacrifice de la totalité de notre temps (de travail et de loisir). Je crois que définir notre temps comme une société sacrificielle permet de mesurer le travail du néant, et donc de susciter des réactions salutaires. Fournir des concepts, n’est-ce pas cela le travail du philosophe?


















 Jérôme Despey : A mon arrivée à la présidence du SIA, je voulais vraiment mettre un pays ami à l'honneur comme le Maroc
Jérôme Despey : A mon arrivée à la présidence du SIA, je voulais vraiment mettre un pays ami à l'honneur comme le Maroc


